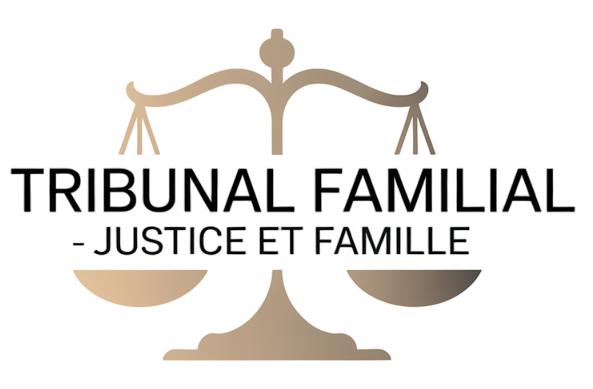En l’absence d’accord : l’intervention du juge aux affaires familiales (JAF)
L’échec de la procédure amiable entraîne l’intervention du tribunal familial. Le Juge aux affaires familiales (JAF) tranche alors les litiges selon plusieurs étapes clairement définies.
1. Évaluation du patrimoine commun et individuel
La liste exacte des biens composant la masse à partager est dressée, en distinguant :
- Les biens propres à chaque époux,
- Les biens communs ou indivis,
- Les dettes à répartir.
Le JAF requiert généralement l’établissement d’un état liquidatif, une sorte de « photographie » du patrimoine réalisée par un notaire. Ce document recense tous les biens (maison, meubles, épargne, assurance vie, dettes, crédits).
Exemple : Si un couple possède une maison valant 300 000 €, un véhicule estimé à 8 000 €, une épargne de 20 000 €, le tout financé en partie par un prêt immobilier restant de 120 000 €, le notaire recense et valorise chaque élément.
À cette étape, des expertises peuvent être ordonnées (par exemple, lorsqu’il y a désaccord sur la valeur d’un bien immobilier).
2. Le débat sur la répartition
Une fois la consistance du patrimoine fixée, le juge vérifie l’origine des biens. Il tient compte des preuves apportées par chacun (actes notariés, relevés bancaires, registres d’assurance…).
- Si l’un des conjoints estime avoir contribué de manière disproportionnée (fonds propres utilisés pour acheter un bien commun), il peut demander une récompense ou une créance.
- Le JAF veille à compenser ces apports personnels.
Un point souvent délicat concerne les dettes : certaines, comme le crédit immobilier pour la résidence familiale, sont partagées à égalité, d’autres restent personnelles (découverts bancaires individuels, dettes contractées sans l’accord du conjoint, etc.).
3. Les critères clés guidant la décision du tribunal
Contrairement à une croyance répandue, le partage ne vise pas forcément une stricte égalité « matérielle ».
- Principe d’égalité : sauf convention différente, chaque époux reçoit la moitié du patrimoine commun.
- Attribution préférentielle : le juge peut attribuer un bien (souvent la résidence principale) à l’un des époux, s’il en fait la demande et justifie d’un intérêt particulier (présence d’enfants, maintien dans le logement…). L’article 831 du Code civil encadre cette disposition.
- La composition des lots : pour éviter la vente d’un bien, le tribunal peut attribuer une soulte (somme d’argent compensatoire) au conjoint qui reçoit un lot inférieur en valeur.
- Edit de la date d’appréciation : sauf circonstances exceptionnelles, la valorisation des biens s’effectue à la date la plus proche de la liquidation, pas à la date de la séparation de fait.
Anecdote : Lors de certaines audiences en correction de lot, il est arrivé que le juge attribue la garde du chien à l’époux ayant la garde principale des enfants, ce qui illustre l’approche pragmatique et humaine du partage.