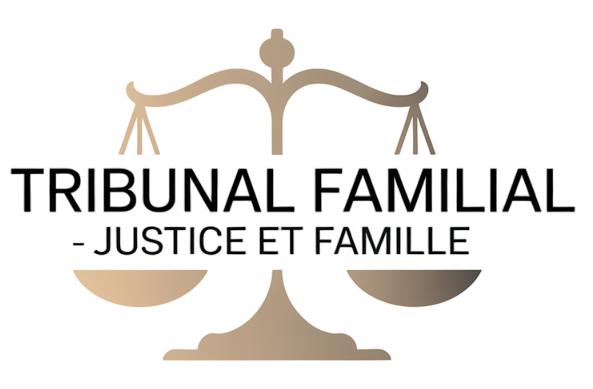Partage des biens en divorce : comment le tribunal familial procède-t-il ?
Le partage des biens lors d’un divorce est une étape déterminante pour les ex-conjoints, qu’ils soient mariés sous un régime de communauté ou de séparation. La procédure varie selon le régime matrimonial...