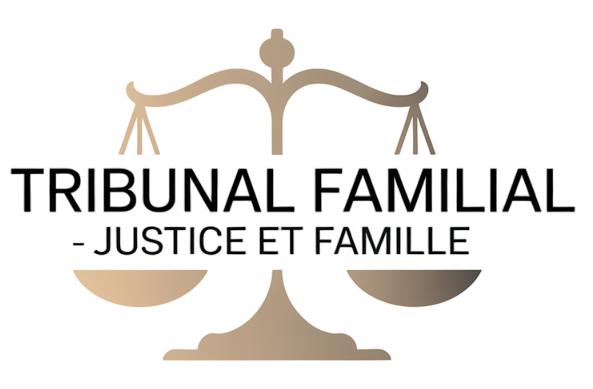Comprendre les régimes matrimoniaux : séparation de biens et communauté devant le tribunal familial
Le régime matrimonial désigne l’ensemble des règles qui déterminent la propriété, la gestion et le partage des biens dans un couple marié. Il s’agit d’un choix juridique posant les bases patrimoniales du...