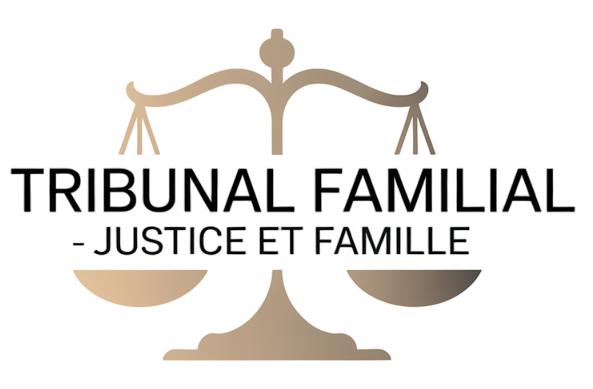Quels sont les frais notariaux lors du partage des biens après divorce ?
1. Émoluments du notaire : un barème réglementé
Le notaire perçoit des émoluments pour son travail. Ce sont des tarifs réglementés fixés par l’État. Pour la liquidation-partage, le calcul s’opère sur la valeur globale des biens à partager.
Par exemple, pour le partage d’un bien immobilier d’une valeur de 250 000 €, le barème applicable au 1er janvier 2023 (cf. Service-public.fr) prévoyait :
- 2 % HT sur la fraction inférieure ou égale à 6 500 €
- 0,83 % HT entre 6 500 € et 17 000 €
- 0,55 % HT entre 17 000 € et 60 000 €
- 0,44 % HT au-delà de 60 000 €
Sur un actif net de 250 000 €, les émoluments s’élèvent donc environ à 1 370 € hors taxes. À cette somme s’ajoutent la TVA (20 % depuis 2014) et, parfois, des “frais et débours” : coûts facturés par le notaire pour obtenir certains documents administratifs (état hypothécaire : 20 €, certificat d’urbanisme : 20 €…).
2. Taxe de partage ou droit de partage : une fiscalité propre au divorce
Au-delà des honoraires du notaire, chaque partage amiable ou judiciaire donne lieu à un impôt appelé “droit de partage”, collecté par le notaire pour le compte du Trésor Public. En 2024, son taux est :
- 1,1 % de l’actif net partagé (déduction faite des dettes communs : capital restant dû sur un emprunt immobilier, par exemple).
Avec notre exemple d’un bien immobilier partagé de valeur 250 000 €, la taxe de partage s’élèvera donc à 2 750 €.
3. Frais annexes notariaux à anticiper
- Frais de publication au service de la publicité foncière (~0,10 % du prix),
- Frais pour copies authentiques,
- Frais d’expertise si la valeur de certains biens est contestée (un expert immobilier peut facturer de 500 à 1 500 €, selon la complexité du bien).
Un point de vigilance : la loi ne fixe pas obligatoirement le paiement des frais de notaire aux deux époux. Souvent, ces frais sont partagés par moitié, mais un accord contraire peut être trouvé (article 815-17 du Code civil).