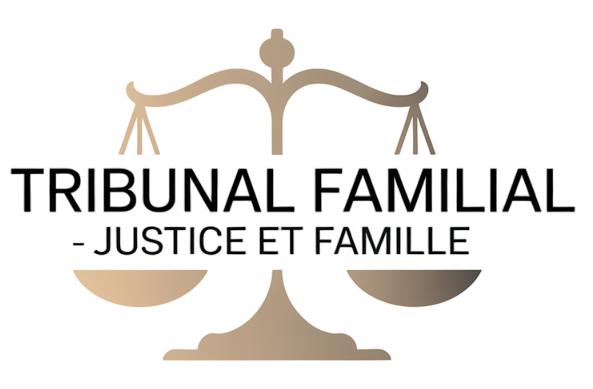Jugement de divorce : comprendre et exercer ses recours devant le tribunal familial
La décision d’un tribunal familial intervient souvent après des mois de procédure et d’attente. Pourtant, 10 à 15 % des jugements de divorce font l’objet d’un recours en France selon les chiffres du ministère de la...