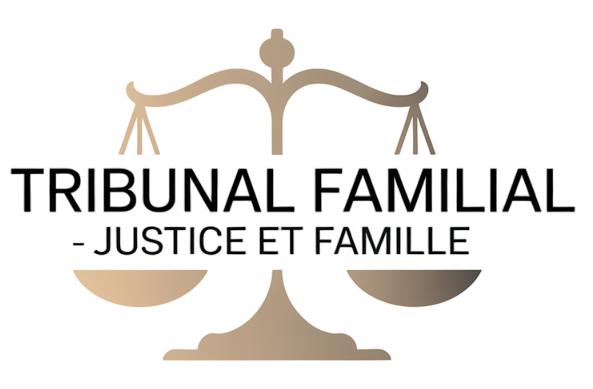Les critères essentiels du tribunal familial pour départager les parents en conflit sur les responsabilités légales
Lorsqu’un conflit éclate entre parents sur la prise de décisions pour leur enfant, il revient au tribunal familial de trancher de manière impartiale afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette...